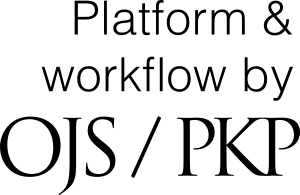Sv. Jurij in sv. Martin na Svetih gorah na Bizeljskem v predromanski dobi
Povzetek
Sur la base des recherches effectuées dans les années 1967 et 1968, l’au[1]teur essaie de résoudre le problème de l’origine de deux chapelles consacrées à St. Georges et à St. Martin. Ces deux chapelles se trouvent au sud de la principale église basilicale consacrée à Marie. La chapelle de St. Georges, qui se trouve plus au nord, est orientée dans l’axe NNE —- SSW, tandis qu’à cause du nivellement de l’extrémité sud de ce plateau, pour lequel l’auteur présume qu’il a été fait artificiellement, la chapelle de St. Martin a la direc[1]tion E—W. Comme les deux bâtiments ont été plusieurs fois remaniés, l’au teur essaie de dissocier les activités particulières et, ce faisant, il a réussi à séparer dans la chapelle de St. Georges quatre, et dans la chapelle de St. Martin trois phase de construction principales. Mais il nexclut pas la pos[1]sibilité que tous les éléments d'une phase ne se seraient pas déroulés en même temps. Certaines des phases déterminées présentent dans les deux chapelles les mêmes éléments. Mais ici aussi, l’auteur admet la possibilité que de ce fait la simultanéité et l'oeuvre d'un même maître ne sont pas attestées. Comme les bâtiments avec leurs phases de construction plus récentes se relient à cer[1]taines phases des trois autres églises de cette colline et que celles-ci seront traitées dans une publication commune, l’auteur se limite au seul traitement de leurs éléments plus anciens. Parmi ceux-ci se rangent les Ie et IIe pério[1]des de construction des chapelles mentionnées. Les recherches, les sondages et les diverses traces dans les murs et le sol ont montré que la Ie phase de construction se limite en essence seulement aux nefs des deux chapelles, en tant qu’ouvragé quadrangulaire (grandeur 3,65 X 2,87 et 4,05 X 3,18 m, épaisseur des murs 0,75 — 0,85 m) sans aucun pres[1]byterium et avec une petite porte d’entrée, qui se termine en demi-cercle à la partie supérieure. Les deux bâtiments avaient à l’intérieur une hauteur d'environ 2,40 m et un plafond droit en bois. Ses traces sont conservées dans les restes des troncs horizontaux dans le mur septentrional de la chapelle de St. Martin et dans les inégalités des murs de la chapelle de St. Georges. Plusieurs traces sur les murs montrent que les bâtiments précisément à cette place ont deux superstructures. Dans la première superstructure on a ouvert deux fenêtres dans la chapelle de St. Georges et peut-être une dans la chapelle de St. Martin, qui a cependant dû être détruite lors de l’ouver[1]ture de la fenêtre quadrangulaire plus récente. L’auteur attribue ces change[1]ments à la IIe phase de construction de ces bâtiments. Le sondage du pres[1]byterium de la chapelle de St. Georges a découvert les fondements du pres[1]byterium quadrangulaire. Sous le revêtement de ciment d’aujourd’hui on a découvert dans le presbyterium seulement une couche plus ancienne du sol, tandis que celle-ci était double dans la nef. Le sol intact de la nef n’a été découvert que sur un tiers de la surface, tandis que dans le reste de l’em[1]placement il était dispersé. Au milieu de la nef se trouvait une plus grande excavation, qui était comblée de terre noire. D’après les éléments conservés dans le mur de la nef, on a découvert que les presbyteriums avaient la même hauteur que le mur avec la première su[1]perstructure. Selon l’auteur, dans cette phase on a aussi ouvert les arcs. D’après les morceaux de bois conservés dans le mortier des murs, il estime que cette phase de construction a connu le plafond droit en bois. D’après ces éléments et quelques autres, l’auteur conclut que dans la Ie et la IIe phase de la construction les deux chapelles appartiennent à la même période. Etant donné ce moment, on a aussi analysé ensemble la facture des murs des deux nefs, le mode d’exécution des portails et des fenêtres et l’orientation des chapelles. Selon l'auteur, beaucoup d’éléments convergents de la construction de culte de la période antique avancée servent de comparaison, à savoir les découvertes, où apparaissent deux constructions de culte simul[1]tanées, l’une à côté de l’autre, comme par ex. sur le territoire de la Carin[1]thie; ou bien en Bosnie et Herzégovine, où entre autre de telles églises se di-stinguent par une orientation différente, comme dans les cas des chapelles traitées. Il est significatif qu’ici pour l’église d’orientation E—W, on présume qu’elle est orthodoxe, alors que la seconde, d’orientation vers le nord, est arienne. Dans ces bâtiments précoces, l’auteur voit aussi les analogies les plus fidèles pour le plan de base irrégulier de la nef, pour la structure de con[1]struction disproportionnée des murs et particulièrement pour le mode d’exé[1]cution des angles de construction. En ce qui concerne les portails, il présume que leur partie supérieure, qui est en essence un bloc de pierre quadrangula[1]ire, allongé, coupé en demi-cercle à la partie inférieure, a sans doute son origine dans les éléments à arcades antiques similaires ou les portails ana[1]logues des aedicules antiques. A la différence de ces éléments, la construction des murs et la forme de la surface au sol sont, selon l’auteur, la tradition des cultures plus anciennes, qui dans le cercle culturel villageois a vécu aussi à l’époque romaine et jusqu’au haut moyen âge. L’auteur compare les fenêtres de la chapelle de St. Georges avec la fenê[1]tre découverte du mur septentrional de l’église de St. Primož au-dessus de Kamnik, avec laquelle s’accorde ausi le presbyterium quadrangulaire. Ici, l’auteur se demande si, pour cette église aussi, étant donné le plan de base donné, la forme primitive n’est pas limitée seulement à la partie de la nef, ce qui serait attesté par le banc taillé dans la roche vive. A la fin, l’auteur conclut qu’en raison de la nécropole découverte à cette place, les deux chapelles avaient dès les débuts mêmes le caractère de cime[1]tière et que leur origine est liée à la tradition de culte plus ancienne du lieu même. A cet égard, elles se relient au territoire de la Carinthie, avec une influence sensible aussi du sud et du sud-est. Etant donné tous les moments primitifs traités, selon l’auteur, les deux chapelles sont le reflet de la popula[1]tion autochtone et des immigrants ariens, tandis que la IIe phase de construc[1]tion est le reflet de la volonté de style de son temps
Prenosi
Prenosi
Objavljeno
Kako citirati
Številka
Rubrike
Licenca

To delo je licencirano pod Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 mednarodno licenco.
Avtorji jamčijo, da je delo njihova avtorska stvaritev, da v njem niso kršene avtorske pravice tretjih oseb ali kake druge pravice. V primeru zahtevkov tretjih oseb se avtorji zavezujejo, da bodo varovali interese založnika ter da bodo povrnili morebitno škodo.
Podrobneje v rubriki: Prispevki